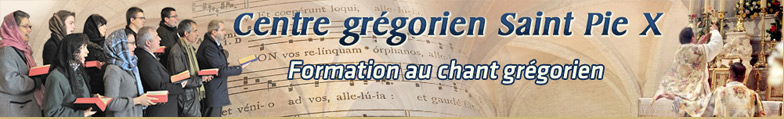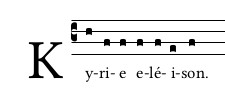session locale à Paris 15 et 22 novembre
Une journée de formation pour mieux remplir son rôle liturgique de choriste. Ouvert à tous les membres de chorales, mais aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir afin de proposer leurs services dans leur chapelle, de 7 à 77 ans.
15 et 22 novembre 2025, de 10h à 17 à la chapelle ND de Consolation, 23 rue Jean Goujon, Paris 8e
- Technique vocale
- Solfège grégorien et classique (lire les notes)
- Le mot latin, le rythme grégorien et le phrasé
- Travail de l’intonation et de la justesse
Organisation pratique :
• venir avec son 800 ou son livre de grégorien et de quoi prendre des notes
• prévoir son pique-nique pour midi
• séances en commun et ateliers par groupes de niveau
• plusieurs professeurs à votre disposition
• organisé par le Centre Grégorien Saint Pie X avec 1 professeur du Centre présent.
• étude des messes des dimanches de l'Avent
Inscription, contact, informations :
abbé Louis-Marie Gélineau
06 72 89 79 39
Pour l'inscription, envoyez un email avec vos coordonnées, votre présence à ces journées, la dernière formation que vous avez suivie (lieu, niveau) et votre pratique chorale (passée et actuelle). Merci.